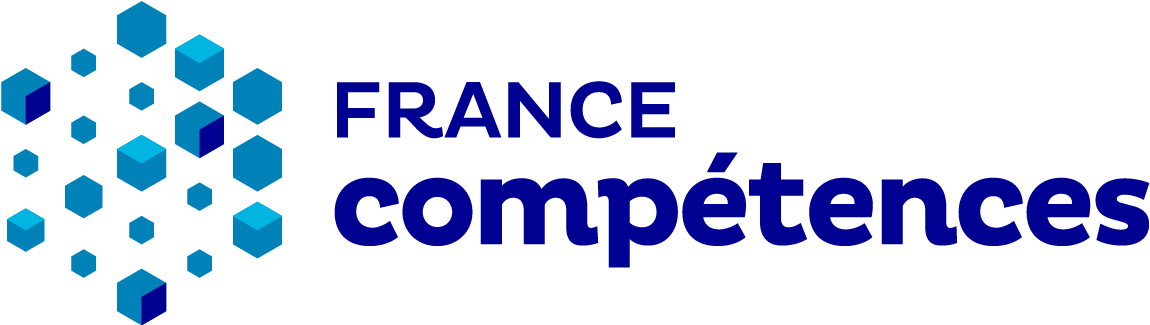L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
128 : Droit, sciences politiques
221r : Contrôle de qualité alimentaire
331r : Prévention, contrôle sanitaire, diététique
Formacode(s)
13254 : Droit
32037 : Gestion communication crise
42881 : Risque criminel entreprise
21570 : Qualité sécurité agroalimentaire
Date d’échéance
de l’enregistrement
25-06-2028
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT (AGROPARISTECH) | 13000285000134 | AgroParisTech | https://www.agroparistech.fr/ |
Objectifs et contexte de la certification :
Le nombre de grandes épidémies au niveau mondial a augmenté à mesure de l’accroissement de la population mondiale, de l’intensification des transports, de la dégradation de l’environnement et du développement des villes. L’activité humaine et les comportements humains, par leurs impacts sur la biodiversité ou le changement climatique, jouent un rôle majeur dans la propagation de maladies infectieuses. Ainsi, la multiplication et la complexité des échanges en matière de denrées, personnes, animaux et végétaux favorisent la transmission de virus, bactéries, toxines et parasites et engendrent parfois des crises sanitaires sans précédent.
Les entreprises se doivent de rester compétitives tout en satisfaisant les normes en vigueur, dont le niveau d’exigence varie d’une région du monde à l’autre et même d’un état à l’autre au sein d’une même zone géographique, comme l’union européenne par exemple.
L'objectif de la certification proposée est de permettre au manager des risques sanitaires alimentaires et environnementaux (MS) de prendre en considération tous les enjeux de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale et d'assurer une prise en charge globale du risque, à la fois sur le plan scientifique mais également juridique, politique, économique et social.
Activités visées :
- Concevoir une politique de gestion des risques sanitaires dans une démarche de santé globale
- Mise en place d’une veille institutionnelle et législative
- Analyse des risques sanitaires
- Définition des objectifs et des stratégies sanitaires et socio-économiques
- Gérer un projet au service de la gestion des risques dans le cadre d’une démarche de santé globale
- Cadrage du projet
- Planification du projet
- Management de l’équipe projet
- Pilotage du projet
- Clôture du projet
- Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires
- Planification du déclenchement de la réponse à la situation de crise
- Coordination de la réponse d’urgence
- Retour d’expérience de la gestion de la crise
- Participer à l’élaboration du cadre législatif et réglementaire
- Proposition de textes législatifs ou réglementaires (loi, décret, circulaire, arrêté…)
- Participation à l’évolution du cadre législatif et réglementaire
Compétences attestées :
Mettre en œuvre une veille institutionnelle et législative pertinente sur les thématiques sanitaire, alimentaire et environnementale en effectuant une recherche active sur les différents supports disponibles (publications et sites Internet, notamment Légifrance, EUR Lex, sites des ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, de l’économie, des institutions européennes) afin d’appuyer son activité sur des sources fiables et actualisées
Cartographier les acteurs des domaines juridique, scientifique, économique et social en charge de l’évaluation des risques sanitaires afin de les mobiliser au sein d’un réseau d’experts pluridisciplinaires
Analyser les incertitudes de la situation, au regard des données et informations disponibles pour en déduire le besoin supplémentaire en évaluation scientifique des risques sanitaires
Réaliser un diagnostic technique, scientifique et règlementaire, en s’appuyant sur les documents existants (rapports d’évaluation, publications) et en sollicitant au besoin les experts pour recueillir les éléments manquants ou incomplets afin d’identifier les risques sanitaires potentiels
Analyser de façon critique les textes juridiques et normatifs qui s’appliquent à la situation afin de situer l’organisme employeur dans son environnement juridique
Rédiger une synthèse de l’évaluation des risques en identifiant avec précision les points clés de la situation (enjeux sanitaires et socio-économiques) afin de mettre en place une approche proactive, réfléchie et adaptative
Hiérarchiser les enjeux sanitaires et socio-économiques en combinant des outils de gestion des risques sanitaires afin de concevoir différents scénarios
Sélectionner le scénario adapté au contexte de l’organisation en s’appuyant sur des critères d’évaluation (impact, coût-bénéfice, conformité réglementaire, etc.) pour permettre une gestion des risques équilibrée et globale
Développer un plan d’actions détaillé en proposant des mesures concrètes afin de décliner la politique de gestion des risques sanitaires de l'organisation
Analyser le contexte global de l’organisation et les risques à anticiper ou atténuer en prenant en compte les diverses menaces auxquelles l'organisation peut être exposée afin de déterminer le but du projet
Prioriser les risques en fonction de la probabilité et de la gravité de leurs effets néfastes sur la santé globale afin d’établir le cahier des charges du projet
Définir le cadre organisationnel du projet en déterminant les instances de gouvernance, les processus de prise de décision, les rôles et les responsabilités afin d'assurer l’efficience de sa coordination
Évaluer les ressources nécessaires au projet sur les plans matériels, humains et financiers afin de mobiliser les ressources en adéquation avec les besoins du projet
Organiser le projet à l'aide d'outils de suivi en identifiant les jalons afin de piloter son avancement
Intégrer des profils interdisciplinaires en identifiant les expertises et les compétences nécessaires afin de constituer une équipe projet
Répartir les tâches et les missions en prenant en compte les situations de handicap des membres de l’équipe si besoin afin de planifier l’activité de manière éthique et socialement responsable
Adapter son approche managériale en prenant en compte la diversité des membres composant l’équipe afin de mettre en place un environnement de travail coopératif
Mettre en place des outils de suivi du projet en se basant sur des indicateurs stratégiques de suivi et de pilotage opérationnels afin de s'assurer du respect des objectifs, des coûts et des délais
Piloter un projet en coordonnant les actions et en suivant l’avancée des actions auprès des différents acteurs impliqués et les performances individuelles et collectives afin de s’assurer du respect des objectifs et des délais du projet
Mesurer l'atteinte des objectifs en valorisant les résultats auprès des parties prenantes afin d’évaluer l'impact global du projet
Mener une analyse approfondie du projet en identifiant les axes de progrès et les points forts afin d’optimiser les pratiques de gestion de projet à venir
Préparer des plans de gestion de crises sanitaires en fonction de scénarios variés (et des signaux faibles identifiés) afin de permettre une réponse plus immédiate, adaptable et flexible
Préparer les infrastructures, les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de réduire le temps à mobiliser des ressources après le début de la crise
Mettre en place un système de surveillance et de détection précoce des menaces et dangers afin d’identifier rapidement l’ampleur des menaces potentielles
Activer le plan de crise en mobilisant les ressources selon le plan établi afin de mettre en place une action coordonnée minimisant la confusion et les erreurs
Piloter la cellule de crise en conservant ses facultés intellectuelles dans un environnement sous pression afin d'optimiser la réactivité
Communiquer auprès des parties prenantes internes et externes de façon claire, transparente et cohérente en élaborant un discours factuel et diplomate afin de permettre la continuité des activités
Organiser un retour d’expérience avec les membres de la cellule de crise en réalisant un diagnostic pour repérer les points positifs et les points critiques dans la gestion de crise sanitaire
Proposer un plan d’actions en interprétant les résultats du diagnostic afin de faire progresser la gestion des crises au sein de la structure
Examiner la législation en vigueur en matière de santé globale et de gestion des risques pour identifier les domaines nécessitant une modification ou une addition
Construire un argumentaire (écrit ou oral) cohérent au service des positions défendues (enjeux socioéconomiques et sanitaires, intérêts de l’organisme, intérêts collectifs) afin d’influer sur les décisions réglementaires et législatives
Convaincre un réseau d’acteurs clés en matière d’adoption des politiques sanitaires en utilisant des méthodes de négociation afin de créer un consensus
Traduire les enjeux de sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale en obligations réglementaires, en s’appuyant sur l’analyse critique des textes juridiques et normatifs applicables afin d’assurer la conformité réglementaire des produits et/ou activités
Rédiger des textes juridiques s’inscrivant dans la hiérarchie des normes en maîtrisant le vocabulaire, la structure, les processus, les acteurs et les étapes d’adoption des textes juridiques afin de soutenir les objectifs de gouvernance et de politique publique
Modalités d'évaluation :
Mises en situation d'analyse de risques et de gestion de crise, de rédaction et de négociation de textes juridiques, mission professionnelle donnant lieu à la rédaction d'une thèse professionnelle et soutenance orale
RNCP40874BC01 - Concevoir une politique de gestion des risques sanitaires dans une démarche de santé globale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Mettre en œuvre une veille institutionnelle et législative pertinente sur les thématiques sanitaire, alimentaire et environnementale en effectuant une recherche active sur les différents supports disponibles (publications et sites Internet, notamment Légifrance, EUR Lex, sites des ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, de l’économie, des institutions européennes) afin d’appuyer son activité sur des sources fiables et actualisées Cartographier les acteurs des domaines juridique, scientifique, économique et social en charge de l’évaluation des risques sanitaires afin de les mobiliser au sein d’un réseau d’experts pluridisciplinaires Analyser les incertitudes de la situation, au regard des données et informations disponibles pour en déduire le besoin supplémentaire en évaluation scientifique des risques sanitaires Réaliser un diagnostic technique, scientifique et règlementaire, en s’appuyant sur les documents existants (rapports d’évaluation, publications) et en sollicitant au besoin les experts pour recueillir les éléments manquants ou incomplets afin d’identifier les risques sanitaires potentiels Analyser de façon critique les textes juridiques et normatifs qui s’appliquent à la situation afin de situer l’organisme employeur dans son environnement juridique Rédiger une synthèse de l’évaluation des risques en identifiant avec précision les points clés de la situation (enjeux sanitaires et socio-économiques) afin de mettre en place une approche proactive, réfléchie et adaptative Hiérarchiser les enjeux sanitaires et socio-économiques en combinant des outils de gestion des risques sanitaires afin de concevoir différents scénarios Sélectionner le scénario adapté au contexte de l’organisation en s’appuyant sur des critères d’évaluation (impact, coût-bénéfice, conformité réglementaire, etc.) pour permettre une gestion des risques équilibrée et globale Développer un plan d’actions détaillé en proposant des mesures concrètes afin de décliner la politique de gestion des risques sanitaires de l'organisation |
Mise en situation d’analyse d’une problématique de gestion des risques Evaluation orale individuelle : présentation du projet et entretien technique avec le jury |
RNCP40874BC02 - Gérer un projet au service de la gestion des risques dans le cadre d’une démarche de santé globale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Analyser le contexte global de l’organisation et les risques à anticiper ou atténuer en prenant en compte les diverses menaces auxquelles l'organisation peut être exposée afin de déterminer le but du projet Prioriser les risques en fonction de la probabilité et de la gravité de leurs effets néfastes sur la santé globale afin d’établir le cahier des charges du projet Définir le cadre organisationnel du projet en déterminant les instances de gouvernance, les processus de prise de décision, les rôles et les responsabilités afin d'assurer l’efficience de sa coordination Évaluer les ressources nécessaires au projet sur les plans matériels, humains et financiers afin de mobiliser les ressources en adéquation avec les besoins du projet Organiser le projet à l'aide d'outils de suivi en identifiant les jalons afin de piloter son avancement Intégrer des profils interdisciplinaires en identifiant les expertises et les compétences nécessaires afin de constituer une équipe projet Répartir les tâches et les missions en prenant en compte les situations de handicap des membres de l’équipe si besoin afin de planifier l’activité de manière éthique et socialement responsable Adapter son approche managériale en prenant en compte la diversité des membres composant l’équipe afin de mettre en place un environnement de travail coopératif Mettre en place des outils de suivi du projet en se basant sur des indicateurs stratégiques de suivi et de pilotage opérationnels afin de s'assurer du respect des objectifs, des coûts et des délais Piloter un projet en coordonnant les actions et en suivant l’avancée des actions auprès des différents acteurs impliqués et les performances individuelles et collectives afin de s’assurer du respect des objectifs et des délais du projet Mesurer l'atteinte des objectifs en valorisant les résultats auprès des parties prenantes afin d’évaluer l'impact global du projet Mener une analyse approfondie du projet en identifiant les axes de progrès et les points forts afin d’optimiser les pratiques de gestion de projet à venir
|
Rapport de mission professionnelle écrit individuel (10 pages) |
RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Préparer des plans de gestion de crises sanitaires en fonction de scénarios variés (et des signaux faibles identifiés) afin de permettre une réponse plus immédiate, adaptable et flexible Préparer les infrastructures, les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de réduire le temps à mobiliser des ressources après le début de la crise Mettre en place un système de surveillance et de détection précoce des menaces et dangers afin d’identifier rapidement l’ampleur des menaces potentielles Activer le plan de crise en mobilisant les ressources selon le plan établi afin de mettre en place une action coordonnée minimisant la confusion et les erreurs Piloter la cellule de crise en conservant ses facultés intellectuelles dans un environnement sous pression afin d'optimiser la réactivité Communiquer auprès des parties prenantes internes et externes de façon claire, transparente et cohérente en élaborant un discours factuel et diplomate afin de permettre la continuité des activités Organiser un retour d’expérience avec les membres de la cellule de crise en réalisant un diagnostic pour repérer les points positifs et les points critiques dans la gestion de crise sanitaire Proposer un plan d’actions en interprétant les résultats du diagnostic afin de faire progresser la gestion des crises au sein de la structure
|
Mise en situation sur un plateau de crise : Entretien technique individuel |
RNCP40874BC04 - Participer à l’élaboration du cadre législatif et réglementaire
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Examiner la législation en vigueur en matière de santé globale et de gestion des risques pour identifier les domaines nécessitant une modification ou une addition Construire un argumentaire (écrit ou oral) cohérent au service des positions défendues (enjeux socioéconomiques et sanitaires, intérêts de l’organisme, intérêts collectifs) afin d’influer sur les décisions réglementaires et législatives Convaincre un réseau d’acteurs clés en matière d’adoption des politiques sanitaires en utilisant des méthodes de négociation afin de créer un consensus Traduire les enjeux de sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale en obligations réglementaires, en s’appuyant sur l’analyse critique des textes juridiques et normatifs applicables afin d’assurer la conformité réglementaire des produits et/ou activités Rédiger des textes juridiques s’inscrivant dans la hiérarchie des normes en maîtrisant le vocabulaire, la structure, les processus, les acteurs et les étapes d’adoption des textes juridiques afin de soutenir les objectifs de gouvernance et de politique publique |
Mises en situation sur la proposition d’un texte législatif : Soutenance orale individuelle |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Pour obtenir la certification de Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS), le candidat doit valider l’ensemble des quatre blocs de compétences suivant les modalités prévues et valider une thèse professionnelle fondée sur une mission professionnelle correspondant à un réel besoin exprimé par une structure publique ou para-publique ou une entreprise d’une durée comprise entre 6 et 8 mois équivalents temps plein et faisant l’objet d’un rendu écrit individuel et d’une soutenance à l’oral devant un jury.
Dans le cadre d’un dossier VAE, pour obtenir la certification, le candidat doit valider les blocs de compétences et apporter les preuves d‘une production qui prouve qu’il a, pendant son parcours professionnel, mobilisé les compétences visées.
Secteurs d’activités :
Le secteur agroalimentaire
Le secteur pharmaceutique et biotechnologie
L’industrie chimique
Le secteur de l’énergie
Le secteur public
Les organisations interprofessionnelles
Les ONG
Les cabinets de conseil et d'audit
Type d'emplois accessibles :
Ingénieur Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie
Responsable environnement en industrie
Auditeur qualité en industrie
Chargé d'affaires réglementaires en industrie de santé
Ingénieure qualité en industrie
Responsable qualité conformité réglementaire
Responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie
Responsable d'un service déconcentré de l'État
Code(s) ROME :
- H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
- H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
- K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Pour accéder au parcours certifiant, le candidat doit respecter les prérequis suivants :
Titulaires d’un diplôme d’ingénieur en sciences du vivant habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI), sans spécificité de spécialisation ;
Titulaires d’un diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (Master....) ou diplôme professionnel cohérent avec le niveau BAC +5 en sciences du vivant (sans spécificité de spécialisation ou diplôme de vétérinaire, pharmacien ou médecin) ou en droit ;
Titulaires d’un diplôme de M1 en sciences du vivant ou en droit, sans spécificité de spécialisation, pour des candidats justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle ;
Titulaires d’un titre inscrit au RNCP, niveau 7 européen, dans le domaine des sciences du vivant ;
Titulaires d’un diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus.
Par dérogation la formation accueille des auditeurs ne remplissant pas les critères précédemment listés, le pourcentage total des dérogations prévues au a) et au b) ci-dessous ne devant pas excéder 40% :
- a) pour 30 % maximum de l’effectif d’une promotion : Diplôme ou attestation de validation d’un niveau équivalent M1 sans expérience professionnelle ou ayant moins de trois ans d’expérience professionnelle en lien avec la formation visée ou Diplôme de licence (L3) ou grade de Licence ou titre inscrit au RNCP niveau 6 (ancienne nomenclature niveau II) justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum, en lien avec la formation visée.
- b) pour 10% maximum de l’effectif d’une promotion : Les candidats avec VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) justifiant d’au moins 5 années d’expérience professionnelle pour lesquelles les activités exercées ont un lien avéré avec les compétences professionnelles visées par la formation (hors stage, césure, cursus initial en alternance)
Avant l'entrée en formation, les candidats à la certification suivent une formation de remise à niveau en droit. A l’issue de cette remise à niveau, l’accès à la certification est conditionné par la réussite à un examen contrôlant les connaissances acquises.
La sélection des candidats se fait en 2 phases :
- Admissibilité après examen du dossier de candidature
- Admission après épreuve écrite et entretien portant notamment sur le projet professionnel du candidat
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Le jury de certification est composé de 5 personnes, il s’agit de - 3 professionnels en activité avec au moins deux ans d’expérience et n’ayant aucun lien avec les candidats (membres externes à AgroParisTech) ; - La Cheffe du service des formations professionnelles (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant - La responsable de la certification (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury de certification est composé de 5 personnes, il s’agit de - 3 professionnels en activité avec au moins deux ans d’expérience et n’ayant aucun lien avec les candidats (membres externes à AgroParisTech) ; - La Cheffe du service des formations professionnelles (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant - La responsable de la certification (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Le jury de certification est composé de 5 personnes, il s’agit de - 3 professionnels en activité avec au moins deux ans d’expérience et n’ayant aucun lien avec les candidats (membres externes à AgroParisTech) ; - La Cheffe du service des formations professionnelles (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant - La responsable de la certification (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Le jury de certification est composé de 5 personnes, il s’agit de - 3 professionnels en activité avec au moins deux ans d’expérience et n’ayant aucun lien avec les candidats (membres externes à AgroParisTech) ; - La Cheffe du service des formations professionnelles (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant - La responsable de la certification (membre interne à AgroParisTech, agent de la fonction publique) ou son représentant |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en correspondance partielle :
| Bloc(s) de compétences concernés | Code et intitulé de la certification professionnelle reconnue en correspondance partielle | Bloc(s) de compétences en correspondance partielle |
|---|---|---|
| RNCP40874BC01 - Concevoir une politique de gestion des risques sanitaires dans une démarche de santé globale | RNCP36851 - Manager qualité sécurité environnement |
RNCP36851BC01 - Définir la politique QHSE de l’entreprise ET RNCP36851BC03 - Déployer le système de management environnemental de l’entreprise |
| RNCP40874BC01 - Concevoir une politique de gestion des risques sanitaires dans une démarche de santé globale | RNCP37084 - Manager des systèmes intégrés QSE (MS) |
RNCP37084BC01 - Manager des projets au service de la stratégie QSE de l’entreprise ET RNCP37084BC03 - Concevoir le système de management aligné avec la stratégie de l’entreprise ET RNCP37084BC04 - Piloter la performance QSE de l’entreprise et la démarche d’amélioration continue |
| RNCP40874BC01 - Concevoir une politique de gestion des risques sanitaires dans une démarche de santé globale | RNCP37809 - Manager des risques industriels (MS) |
RNCP37809BC02 - Analyser la conformité réglementaire de l’entreprise ET RNCP37809BC03 - Concevoir le système de management SSE aligné avec la stratégie de l'entreprise et en assurer la maintenance ET RNCP37809BC04 - Evaluer et hiérarchiser les risques, recommander et planifier les actions de prévention |
| RNCP40874BC02 - Gérer un projet au service de la gestion des risques dans le cadre d’une démarche de santé globale | RNCP37812 - Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école polytechnique de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et gestion des risques |
RNCP37812BC01 - Concevoir, optimiser, mettre en œuvre et gérer les activités de management opérationnel ET RNCP37812BC04 - Concevoir, mettre en œuvre, organiser et superviser les activités de management de projets ET RNCP37812BC07 - Concevoir, mettre en œuvre, organiser et superviser une démarche qualité |
| RNCP40874BC02 - Gérer un projet au service de la gestion des risques dans le cadre d’une démarche de santé globale | RNCP37959 - Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires de l'Université de Lorraine, spécialité Industries alimentaires | RNCP37959BC04 - Gérer des projets multi-acteurs : Piloter un projet dans le domaine agroalimentaire ou biotechnologique en respectant les contraintes techniques, économiques, sociétales, environnementales, règlementaires |
| RNCP40874BC02 - Gérer un projet au service de la gestion des risques dans le cadre d’une démarche de santé globale | RNCP38328 - Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Institut national d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement | RNCP38328BC03 - Concevoir et proposer des solutions innovantes dans les champs thématiques de l'agriculture, de l'environnement, de l'alimentation et du territoire |
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP35214 - Manager des risques QHSE | RNCP35214BC04 - Mise en œuvre de la gestion globale des risques de qualité, de sécurité / sûreté et d’environnement |
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP36225 - Expert en prévention des risques et en gestion des crises dans l'industrie (MS) | RNCP36225BC03 - Gérer les crises liées aux accidents industriels majeurs |
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP36228 - Responsable gestion de crise |
RNCP36228BC02 - Définir le processus de crise au sein d'une organisation et préparer à la prise de décision en situation de crise ET RNCP36228BC03 - Construire et mettre en place les outils et dispositifs de réponse à la crise ET RNCP36228BC04 - Contribuer à une stratégie de communication adaptée au processus de crise de sa structure |
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP37084 - Manager des systèmes intégrés QSE (MS) | RNCP37084BC04 - Piloter la performance QSE de l’entreprise et la démarche d’amélioration continue |
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP37812 - Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école polytechnique de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et gestion des risques | RNCP37812BC03 - Analyser, mettre en œuvre et gérer les activités de maîtrise des risques industriels |
Anciennes versions de la certification professionnelle reconnues en correspondance partielle :
| Bloc(s) de compétences concernés | Code et intitulé de la certification professionnelle reconnue en correspondance partielle | Bloc(s) de compétences en correspondance partielle |
|---|---|---|
| RNCP40874BC03 - Mettre en œuvre une politique de gestion de crises sanitaires | RNCP36657 - Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS) | RNCP36657BC02 - Mettre en œuvre une politique de gestion des risques sanitaires et/ou de crises sanitaires |
| RNCP40874BC04 - Participer à l’élaboration du cadre législatif et réglementaire | RNCP36657 - Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS) | RNCP36657BC01 - Concevoir et négocier une politique de gestion des risques sanitaires et sa transcription juridique dans une démarche de santé globale |
| RNCP40874BC04 - Participer à l’élaboration du cadre législatif et réglementaire | RNCP36657 - Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS) | RNCP36657BC03 - Assurer la conformité réglementaire des produits et/ou activités |
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 03/03/2017 |
Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel du 03 mars 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé " Manager des risques sanitaires alimentaires et environnementaux (MS)" avec effet au 19 janvier 2012, jusqu'au 03 mars 2022. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
01-07-2022
| Date de décision | 25-06-2025 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 3 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 25-06-2028 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 25-06-2032 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 100 | 100 | - |
| 2022 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2021 | 12 | 0 | 91 | 91 | 92 |
| 2020 | 6 | 0 | 100 | 80 | 80 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://formation-continue.agroparistech.fr/catalogue-de-formation/mastere-specialise-management-risques-sanitaires-alimentaires-environnementaux-ms
Liste des organismes préparant à la certification :
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP36657 | Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS) |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :