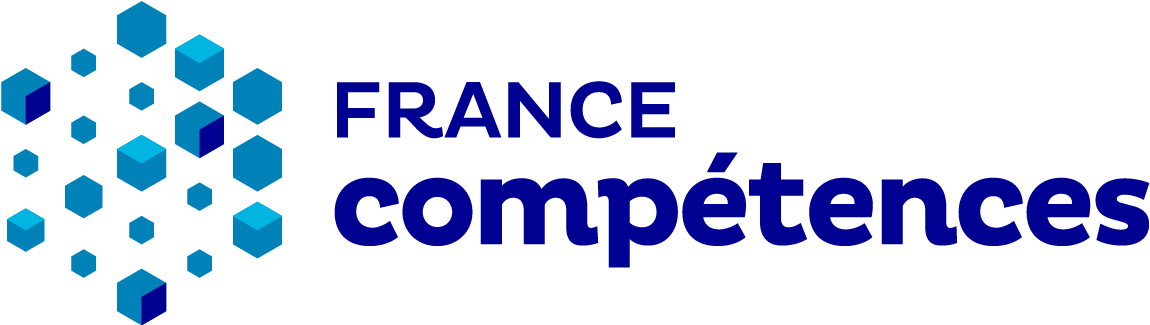L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
332n : Expertise sociale et projets sociaux
341p : Gestion de l'espace et mise en oeuvre des projets
Formacode(s)
13175 : Économie sociale
12523 : Développement local
13016 : Aide développement
32135 : Conduite projet
Date d’échéance
de l’enregistrement
18-07-2030
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| IFAID | 33884976300036 | IFAID | https://ifaid.org |
Objectifs et contexte de la certification :
Le métier de Coordonnateur de projet de solidarités a connu une évolution significative ces dernières décennies, marquée par une complexification des enjeux de la solidarité, une montée en compétences des acteurs et une diversification des financements. Initialement centré sur l’aide au développement et la gestion de l’urgence, ce métier s’est transformé pour inclure la gestion stratégique, le pilotage multi-acteurs et l’évaluation d’impact des projets.
Le renouvellement de cette certification s’inscrit dans un contexte où plusieurs transformations majeures impactent le secteur :
- L’évolution des politiques publiques et des financements internationaux : La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 sur le développement solidaire impose des objectifs d’efficacité et de redevabilité renforcés, nécessitant une maîtrise avancée des logiques d’évaluation, de suivi budgétaire et de financement hybride (subventions, fonds privés, ESS, financement participatif, etc.).
- L’intégration des enjeux des transitions écologiques et sociales : Les professionnels doivent désormais intégrer les dimensions environnementales et sociales dans leurs stratégies d’intervention et savoir mobiliser les bailleurs de fonds et partenaires institutionnels autour de projets à fort impact territorial et sociétal.
- L’essor du numérique et des nouvelles méthodologies de gestion de projet : Le pilotage à distance, la gestion d’équipes interculturelles et la collecte de données via des outils collaboratifs avancés font désormais partie des compétences requises au niveau cadre.
- L’augmentation des crises globales et leur impact sur la solidarité : Les conflits, les migrations et les catastrophes environnementales nécessitent des capacités d’analyse stratégique, d’adaptation rapide et de gestion des risques à un niveau d’expertise élevé.
Le Coordonnateur de projet de solidarités intervient désormais comme un expert capable de concevoir et piloter des stratégies complexes, en assurant la mise en œuvre et l’évaluation de projets impliquant une diversité d’acteurs et de ressources. Il ne se limite plus à une fonction opérationnelle, mais assume une responsabilité décisionnelle élevée, impliquant :
- L’élaboration de stratégies territoriales et internationales, avec une capacité à aligner les projets sur les politiques publiques, les ODD et les financements internationaux.
- Le pilotage budgétaire et la gestion financière avancée, intégrant l’optimisation des ressources et la diversification des financements.
- La gouvernance et la gestion des partenariats stratégiques, incluant la négociation avec des institutions, des entreprises sociales et des bailleurs internationaux.
- L’évaluation d’impact et la mesure de la performance des projets, par le biais de méthodologies rigoureuses et d’outils numériques spécialisés.
Activités visées :
Réalisation d’un diagnostic territorial
Initiation de partenariats sur un territoire
Conception de projet
Pilotage et évaluation du projet
Management d’équipe
Animation d’un réseau et sensibilisation d’acteurs
Réalisation d’un diagnostic organisationnel incluant une analyse économique
Elaboration de stratégie et consolidation du modèle économique
Compétences attestées :
Conduire une analyse exploratoire en s’appuyant sur une méthodologie de recherche documentaire pour identifier et sélectionner des sources documentaires pertinentes (données secondaires) en vue de présenter un exposé du contexte documenté et structuré permettant de s’acculturer aux enjeux (géopolitiques, sociétaux, environnementaux) à l’échelle d’un territoire et d’appréhender leur complexité, préalable à une enquête terrain.
Concevoir une méthodologie d’enquête en s’appuyant sur une approche systémique, et utilisant des outils méthodologiques et informatiques de collecte d’information adaptés (cartographie, questionnaires, entretiens), en vue de produire une note méthodologique à destination du commanditaire de l’enquête territoriale.
Piloter une enquête, en mettant en œuvre le processus structuré défini en amont et en s’appuyant sur des questionnaires adaptés, en vue de collecter les informations auprès des acteurs du territoire (données primaires) et d’analyser les résultats.
Proposer un plan d’action, en s’appuyant sur les données significatives ressortant de l’enquête, en vue de préparer l’élaboration d’un projet en réponse aux besoins et problématiques identifiés via l’enquête.
Présenter les résultats du diagnostic territorial auprès des parties prenantes et décideurs en synthétisant l’information de façon structurée et attrayante, et en mobilisant des techniques de communication afin de donner des éléments utiles à une prise de décision éclairée sur le plan d’action à suivre.
Établir des partenariats durables sur le territoire en ayant au préalable identifié les acteurs, leurs typologies et statuts en s’appuyant sur la mise en place de forums participatifs, réponse en consortium à des appels à projet, ou élaboration de conventions de partenariats, en vue de tisser des liens avec son écosystème, créer des synergies et favoriser le développement de projets concertés.
Structurer un projet de manière concertée en s’appuyant sur un cadre logique tenant compte des enjeux sociétaux en vue de préciser les actions à mener, les résultats visés, et les moyens pour y parvenir.
Préparer un planning prévisionnel en détaillant les actions à mener, les ressources mobilisées et le temps nécessaire pour les mettre en œuvre, en vue de s’accorder avec les acteurs du projet et le commanditaire sur les principales échéances attendues.
Élaborer un budget prévisionnel et une stratégie de financement, en s’appuyant l’inventaire des ressources nécessaires à la réalisation du projet, en vue de répondre à un appel à projet et le défendre devant un financeur.
Piloter un projet en s’appuyant des outils de gestion de projet et des méthodes de suivi des actions, d’anticipation et de réduction des risques, en vue de tenir les délais et engagement pris avec le commanditaire et de mieux prévoir, le cas échéant, les actions utiles à la résolution de problème.
Accompagner les prises de décisions tout au long du projet en tenant compte grands enjeux sociétaux et des objectifs de développement durable (publics en situation de minorité, précarité, exclusion : sécurité alimentaire, accès au logement, droits des femmes, jeunes, enfants, question du genre, migrants/demandeurs d'asile, impact environnemental, biodiversité, protection animale, etc.) en s’appuyant sur le cadre légal des bénéficiaires et des sources d’informations accréditées (ex. Ademe) afin d’inscrire son action dans le respect de l’environnement, des publics, et des lois.
Suivre un projet en développement, en utilisant et en mettant à jour les outils notamment digitaux adaptés en vue d’effectuer le suivi budgétaire et de mettre à jour des indicateurs de suivi et de mesure des résultats obtenus nécessaires au reporting.
Réaliser un rapport à destination interne (équipes, bénéficiaires, siège, gouvernance) et externe (partenaires, parties prenantes, financeurs) sur son projet, en utilisant des outils de communications adaptés en vue d’informer les parties prenantes sur les principales réussites, difficultés, délais et risques éventuels, et évolutions possibles du projet, dans les temps définis et en adéquation avec les exigences des financeurs.
Évaluer un projet, en s’appuyant sur des outils de mesure d’impact, d'évaluation et sur des procédures d’audit, en vue de transmettre aux financeurs et aux parties prenantes le bilan quantitatif et qualitatif, les éléments preuve des résultats obtenus, de l’impact et de la qualité du projet.
Capitaliser sur l’expérience acquise au cours du projet en s’appuyant sur les données issues des évaluations de projet, des ateliers d’échanges avec les acteurs, en vue de renforcer les compétences des acteurs du projet et de favoriser le développement d’une démarche d’amélioration continue
Recruter des ressources humaines dans un cadre associatif (bénévoles, volontaires, salariés), et dans le respect des différences et de la diversité (genre, culture, handicap…), en s’appuyant sur des outils et méthodes de recrutement, en vue de compléter l’équipe dédiés au projet et déployer les activités en lien dans de bonnes conditions
Superviser une équipe composée de bénévoles, volontaires, et/ou salariés, en présentiel ou à distance, en s’appuyant sur des outils et méthodes de management, cadrage projet, et d’animation d’équipe, dans le respect des différences et de la diversité (genre, culture, handicap…) et en tenant compte du droit du travail, en vue de répondre de façon adéquate aux situations rencontrées dans le cadre professionnel.
Favoriser de bonnes conditions de travail pour soi et pour les acteurs du projet, en s’appuyant sur des outils de communication interne, et des techniques de gestion du stress ou de résolution de conflits, en vue de mettre en œuvre des projets de solidarité.
Coordonner un réseau d’acteurs en s’appuyant sur des méthodes et outils de facilitation de groupes et d’intelligence collective, en vue de mobiliser des ressources et des partenaires et de les faire travailler ensemble autour d'un projet ou d’un événement.
Résoudre les éventuels conflits entre acteurs en adaptant sa communication et son langage en fonction de son interlocuteur, de l'environnement culturel, du niveau de connaissance, d’expérience, de vulnérabilité, en s’appuyant sur des techniques de communication, et des grilles de lectures concernant les différences interculturelles, en vue d’accompagner le changement au sein du collectif.
Animer des ateliers de sensibilisation ou de mobilisation sociale en s’appuyant sur des techniques de formation, et des outils d’éducation populaire, en vue de générer une prise de conscience et passage à l’action de la société civile autour de problématiques sociétales et environnementales, ou de répondre à des besoins de publics vulnérables.
Concevoir de manière concertée une méthodologie de diagnostic organisationnel, en s’appuyant sur des outils et grilles de questionnement de l'ensemble des composantes d'une organisation de solidarité (histoire, valeurs, identité de la structure, modèle de gouvernance, activité, ressources humaines, modèle économique, relations partenariales...) en vue de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration de la stratégie de l’organisation.
Analyser la situation économique et financière d'une organisation en s’appuyant sur le bilan, compte-de résultat, plan de trésorerie, en vue de faciliter la décision sur le financement de nouveaux projets ou l’évolution du modèle économique.
Définir la stratégie d'une organisation en s’appuyant sur l’analyse systémique des données recueillies dans la phase de diagnostic organisationnel et l’utilisation de modèles économiques intégrant la responsabilité sociale des organisations (RSO), en vue de consolider durablement l'organisation.
Construire une stratégie et un plan de communication en s’appuyant sur des techniques et outils de communication adaptés, en vue de communiquer en interne et en externe sur l’organisation et de convaincre le public visé de la pertinence du projet porté.
Modalités d'évaluation :
Travaux écrits en individuel et collectif, soutenances orales individuelles et collectives, études de cas en individuel et collectif, mises en situation individuelles et collectives, réalisation d'un dossier professionnel soutenu oralement
RNCP41124BC01 - Réaliser un diagnostic en mobilisant les acteurs d’un territoire
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Conduire une analyse exploratoire en s’appuyant sur une méthodologie de recherche documentaire pour identifier et sélectionner des sources documentaires pertinentes (données secondaires) en vue de présenter un exposé du contexte documenté et structuré permettant de s’acculturer aux enjeux (géopolitiques, sociétaux, environnementaux) à l’échelle d’un territoire et d’appréhender leur complexité, préalable à une enquête terrain. Concevoir une méthodologie d’enquête en s’appuyant sur une approche systémique, et utilisant des outils méthodologiques et informatiques de collecte d’information adaptés (cartographie, questionnaires, entretiens), en vue de produire une note méthodologique à destination du commanditaire de l’enquête territoriale. Piloter une enquête, en mettant en œuvre le processus structuré défini en amont et en s’appuyant sur des questionnaires adaptés, en vue de collecter les informations auprès des acteurs du territoire (données primaires) et d’analyser les résultats. Proposer un plan d’action, en s’appuyant sur les données significatives ressortant de l’enquête, en vue de préparer l’élaboration d’un projet en réponse aux besoins et problématiques identifiés via l’enquête. Présenter les résultats du diagnostic territorial auprès des parties prenantes et décideurs en synthétisant l’information de façon structurée et attrayante, et en mobilisant des techniques de communication afin de donner des éléments utiles à une prise de décision éclairée sur le plan d’action à suivre. Établir des partenariats durables sur le territoire en ayant au préalable identifié les acteurs, leurs typologies et statuts en s’appuyant sur la mise en place de forums participatifs, réponse en consortium à des appels à projet, ou élaboration de conventions de partenariats, en vue de tisser des liens avec son écosystème, créer des synergies et favoriser le développement de projets concertés. |
Travaux écrits en collectif, soutenances orales, étude de cas en individuel |
RNCP41124BC02 - Concevoir et piloter un projet de solidarité intégrant des enjeux de transition écologique et/ou sociale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Structurer un projet de manière concertée en s’appuyant sur un cadre logique tenant compte des enjeux sociétaux en vue de préciser les actions à mener, les résultats visés, et les moyens pour y parvenir. Préparer un planning prévisionnel en détaillant les actions à mener, les ressources mobilisées et le temps nécessaire pour les mettre en œuvre, en vue de s’accorder avec les acteurs du projet et le commanditaire sur les principales échéances attendues. Élaborer un budget prévisionnel et une stratégie de financement, en s’appuyant l’inventaire des ressources nécessaires à la réalisation du projet, en vue de répondre à un appel à projet et le défendre devant un financeur. Piloter un projet en s’appuyant des outils de gestion de projet et des méthodes de suivi des actions, d’anticipation et de réduction des risques, en vue de tenir les délais et engagement pris avec le commanditaire et de mieux prévoir, le cas échéant, les actions utiles à la résolution de problème. Accompagner les prises de décisions tout au long du projet en tenant compte grands enjeux sociétaux et des objectifs de développement durable (publics en situation de minorité, précarité, exclusion : sécurité alimentaire, accès au logement, droits des femmes, jeunes, enfants, question du genre, migrants/demandeurs d'asile, impact environnemental, biodiversité, protection animale, etc.) en s’appuyant sur le cadre légal des bénéficiaires et des sources d’informations accréditées (ex. Ademe) afin d’inscrire son action dans le respect de l’environnement, des publics, et des lois. Suivre un projet en développement, en utilisant et en mettant à jour les outils notamment digitaux adaptés en vue d’effectuer le suivi budgétaire et de mettre à jour des indicateurs de suivi et de mesure des résultats obtenus nécessaires au reporting. Réaliser un rapport à destination interne (équipes, bénéficiaires, siège, gouvernance) et externe (partenaires, parties prenantes, financeurs) sur son projet, en utilisant des outils de communications adaptés en vue d’informer les parties prenantes sur les principales réussites, difficultés, délais et risques éventuels, et évolutions possibles du projet, dans les temps définis et en adéquation avec les exigences des financeurs. Évaluer un projet, en s’appuyant sur des outils de mesure d’impact, d'évaluation et sur des procédures d’audit, en vue de transmettre aux financeurs et aux parties prenantes le bilan quantitatif et qualitatif, les éléments preuve des résultats obtenus, de l’impact et de la qualité du projet. Capitaliser sur l’expérience acquise au cours du projet en s’appuyant sur les données issues des évaluations de projet, des ateliers d’échanges avec les acteurs, en vue de renforcer les compétences des acteurs du projet et de favoriser le développement d’une démarche d’amélioration continue |
Etude de cas en individuel, mise en situation collective et soutenance orale |
RNCP41124BC03 - Manager des ressources humaines et animer des partenariats dans un projet de solidarité
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Recruter des ressources humaines dans un cadre associatif (bénévoles, volontaires, salariés), et dans le respect des différences et de la diversité (genre, culture, handicap…), en s’appuyant sur des outils et méthodes de recrutement, en vue de compléter l’équipe dédiés au projet et déployer les activités en lien dans de bonnes conditions Superviser une équipe composée de bénévoles, volontaires, et/ou salariés, en présentiel ou à distance, en s’appuyant sur des outils et méthodes de management, cadrage projet, et d’animation d’équipe, dans le respect des différences et de la diversité (genre, culture, handicap…) et en tenant compte du droit du travail, en vue de répondre de façon adéquate aux situations rencontrées dans le cadre professionnel. Favoriser de bonnes conditions de travail pour soi et pour les acteurs du projet, en s’appuyant sur des outils de communication interne, et des techniques de gestion du stress ou de résolution de conflits, en vue de mettre en œuvre des projets de solidarité. Coordonner un réseau d’acteurs en s’appuyant sur des méthodes et outils de facilitation de groupes et d’intelligence collective, en vue de mobiliser des ressources et des partenaires et de les faire travailler ensemble autour d'un projet ou d’un événement. Résoudre les éventuels conflits entre acteurs en adaptant sa communication et son langage en fonction de son interlocuteur, de l'environnement culturel, du niveau de connaissance, d’expérience, de vulnérabilité, en s’appuyant sur des techniques de communication, et des grilles de lectures concernant les différences interculturelles, en vue d’accompagner le changement au sein du collectif. Animer des ateliers de sensibilisation ou de mobilisation sociale en s’appuyant sur des techniques de formation, et des outils d’éducation populaire, en vue de générer une prise de conscience et passage à l’action de la société civile autour de problématiques sociétales et environnementales, ou de répondre à des besoins de publics vulnérables. |
Etude de cas en individuel et soutenance orale, mises en situation orales et écrite en individuel |
RNCP41124BC04 - Définir et mettre en œuvre la stratégie d’une structure de solidarité
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Concevoir de manière concertée une méthodologie de diagnostic organisationnel, en s’appuyant sur des outils et grilles de questionnement de l'ensemble des composantes d'une organisation de solidarité (histoire, valeurs, identité de la structure, modèle de gouvernance, activité, ressources humaines, modèle économique, relations partenariales...) en vue de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration de la stratégie de l’organisation. Analyser la situation économique et financière d'une organisation en s’appuyant sur le bilan, compte-de résultat, plan de trésorerie, en vue de faciliter la décision sur le financement de nouveaux projets ou l’évolution du modèle économique. Définir la stratégie d'une organisation en s’appuyant sur l’analyse systémique des données recueillies dans la phase de diagnostic organisationnel et l’utilisation de modèles économiques intégrant la responsabilité sociale des organisations (RSO), en vue de consolider durablement l'organisation. Construire une stratégie et un plan de communication en s’appuyant sur des techniques et outils de communication adaptés, en vue de communiquer en interne et en externe sur l’organisation et de convaincre le public visé de la pertinence du projet porté. |
Travaux écrits en collectif et soutenances orales, travail écrit en individuel |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Pour obtenir la certification, les 4 blocs de compétences la composant doivent être validés ainsi que l'épreuve finale (dossier professionnel soutenu oralement).
Secteurs d’activités :
Le coordonnateur de projet de solidarités est un professionnel chargé de concevoir, piloter et évaluer des projets de solidarité visant à répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux à l’échelle locale, nationale ou internationale. Son rôle est essentiel dans la mise en œuvre d’actions de développement, d’urgence humanitaire, de coopération internationale ou d’économie sociale et solidaire (ESS). Il intervient aussi bien au sein d’ONG, d’associations, de collectivités territoriales, d’institutions publiques ou encore d’organisations internationales. Son niveau d’expertise lui permet d’anticiper les évolutions des politiques publiques et des financements internationaux, et d’adapter les stratégies de projet en fonction des tendances socio-économiques et environnementales.
Type d'emplois accessibles :
Agent de développement local
Animateur de réseaux
Chargé de mission
Chargé de projet
Chargé de programme
Coordonnateur de projet
Coordonnateur de programme
Coordonnateur de projet
Chef de projet
Responsable de projet
Responsable de programme
Responsable d'antenne
Responsable de service
Responsable de structure
Responsable de zone
Code(s) ROME :
- K1802 - Développement local
- M1403 - Études et prospectives socio-économiques
- K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
- M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le métier de Coordonnateur de projet de solidarités ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique imposant une certification obligatoire ou un encadrement légal strict pour son exercice. Toutefois, son cadre d’action est influencé par plusieurs réglementations et normes qui encadrent les secteurs de la solidarité internationale, de l’économie sociale et solidaire (ESS), ainsi que du développement local.
1. Cadre réglementaire général du secteur de la solidarité internationale et locale
- Loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 : Cette loi définit les structures de l’ESS, qui sont parmi les principaux employeurs des coordonnateurs de projet. Elle encadre les statuts juridiques des associations, coopératives et fondations, ainsi que les conditions de financement et de gouvernance des projets solidaires.
- Code du travail et réglementation des contrats aidés et du volontariat : Les coordonnateurs peuvent être amenés à encadrer des volontaires internationaux sous divers statuts :
- Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) (Loi n°2005-159 du 23 février 2005, modifiée par l’article 8 de la Loi 2021-1031 du 4 août 2021)
- Service Civique (Loi n°2010-241 du 10 mars 2010)
- Ils doivent aussi appliquer le droit du travail lorsqu’ils recrutent des salariés, notamment en matière de gestion RH, droit des associations et contrats aidés.
- Cadre juridique des financements publics et européens : l’accès aux financements pour les projets de solidarité est encadré par des réglementations spécifiques :
- Réglementation des financements de l’Agence Française de Développement (AFD)
- Normes de transparence financière imposées par les bailleurs européens (ex. : Fonds européen de développement, Erasmus+, FSE).
2. Réglementation spécifique aux projets de solidarité internationale
- Normes humanitaires et principes éthiques
- Principes humanitaires fondamentaux définis par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (humanité, neutralité, impartialité, indépendance).
- Adhésion aux standards internationaux de coordination humanitaire sous l’égide de l’ONU (Cluster System).
- Normes du CHS Alliance et du Core Humanitarian Standard (CHS) sur la qualité et la redevabilité des actions humanitaires.
- Droit international et respect des populations bénéficiaires
- Convention de Genève et droit humanitaire international, garantissant la protection des populations vulnérables.
- Législation sur la protection des données (RGPD), essentielle pour la gestion d’informations sensibles dans les projets sociaux et humanitaires.
3. Réglementation applicable aux projets de coopération décentralisée et territoriale : les projets menés dans le cadre des collectivités territoriales sont soumis à des textes législatifs encadrant la coopération internationale des collectivités locales :
- Loi Thiollière du 7 juillet 2014 (Article L1115-1 du CGCT)
- Autorise les collectivités françaises à financer et piloter des projets de coopération internationale et de solidarité.
- Circulaire du 2 juillet 2021 sur l’action extérieure des collectivités
- Définit les modalités de coopération décentralisée et de soutien aux projets internationaux des territoires français.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Être titulaire d’un niveau 6 en lien avec l'un des domaines suivants : social, santé, développement rural, économie sociale, environnement, gestion
Ou être titulaire d’un niveau 6 et posséder une expérience de six mois minimum dans l'un des domaines suivants : social, santé, développement rural, économie sociale, environnement, gestion
Ou être titulaire d’un niveau 5 et posséder une expérience de deux ans minimum dans l'un des domaines suivants : social, santé, développement rural, économie sociale, environnement, gestion
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X |
2 membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification, représentant les 2 principaux secteurs d’activité des candidats à la certification 1 membre représentant l’autorité délivrant la certification |
18-07-2025 | |
| Après un parcours de formation continue | X |
2 membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification, représentant les 2 principaux secteurs d’activité des candidats à la certification 1 membre représentant l’autorité délivrant la certification |
18-07-2025 | |
| En contrat de professionnalisation | X |
2 membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification, représentant les 2 principaux secteurs d’activité des candidats à la certification 1 membre représentant l’autorité délivrant la certification |
18-07-2025 | |
| Par candidature individuelle | X |
2 membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification, représentant les 2 principaux secteurs d’activité des candidats à la certification 1 membre représentant l’autorité délivrant la certification |
18-07-2025 | |
| Par expérience | X |
2 membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification, représentant les 2 principaux secteurs d’activité des candidats à la certification 1 membre représentant l’autorité délivrant la certification |
18-07-2025 |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en correspondance partielle :
| Bloc(s) de compétences concernés | Code et intitulé de la certification professionnelle reconnue en correspondance partielle | Bloc(s) de compétences en correspondance partielle |
|---|---|---|
| RNCP41124BC02 - Concevoir et piloter un projet de solidarité intégrant des enjeux de transition écologique et/ou sociale | RNCP35658 - Coordinateur de programme humanitaire | RNCP35658BC01 - Concevoir et piloter des projets humanitaires dans le respect d'une démarche qualité et des normes humanitaires |
|
RNCP41124BC02 - Concevoir et piloter un projet de solidarité intégrant des enjeux de transition écologique et/ou sociale ET RNCP41124BC03 - Manager des ressources humaines et animer des partenariats dans un projet de solidarité |
RNCP39386 - Manager de projets nationaux et internationaux des organisations |
RNCP39386BC03 - Piloter la mise en œuvre opérationnelle des projets de développement responsables ET RNCP39386BC04 - Manager et animer des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires |
Anciennes versions de la certification professionnelle reconnues en correspondance partielle :
| Bloc(s) de compétences concernés | Code et intitulé de la certification professionnelle reconnue en correspondance partielle | Bloc(s) de compétences en correspondance partielle |
|---|---|---|
| RNCP41124BC01 - Réaliser un diagnostic en mobilisant les acteurs d’un territoire | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC01 - Réaliser un diagnostic global et concerté |
| RNCP41124BC02 - Concevoir et piloter un projet de solidarité intégrant des enjeux de transition écologique et/ou sociale | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC02 - Concevoir et piloter un projet de solidarité internationale et locale |
| RNCP41124BC03 - Manager des ressources humaines et animer des partenariats dans un projet de solidarité | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC03 - Renforcer les organisations de la solidarité |
| RNCP41124BC03 - Manager des ressources humaines et animer des partenariats dans un projet de solidarité | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC04 - Développer la participation des acteurs locaux |
| RNCP41124BC03 - Manager des ressources humaines et animer des partenariats dans un projet de solidarité | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC05 - Manager les ressources humaines |
| RNCP41124BC04 - Définir et mettre en œuvre la stratégie d’une structure de solidarité | RNCP36705 - Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale | RNCP36705BC03 - Renforcer les organisations de la solidarité |
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 07/07/1994 |
Arrêté du 25 juin 1994 publié au Journal Officiel du 7 juillet 1994 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Diplôme de spécialisation en développement, filières : santé, rurale, technique'. Titre délivré par BIOFORCE AQUITAINE. |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 17/03/2016 |
Arrêté du 25 février 2016 publié au Journal Officiel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale" avec effet au 31 décembre 2015, jusqu'au 17 mars 2021. |
| 10/04/2010 |
Arrêté du 30 mars 2010 publié au Journal Officiel du 10 avril 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale" avec effet au 10 avril 2010, jusqu'au 10 avril 2015. |
| 12/10/2002 |
Arrêté du 3 octobre 2002 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2002 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique. Observations : L'homologation prend effet à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 2003. |
| 10/10/2004 |
Arrêté du 8 octobre 2004 publié au Journal Officiel du 10 octobre 2004 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans. |
| 26/07/1998 |
Arrêté du 17 juillet 1998 publié au Journal Officiel du 26 juillet 1998 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Coordonnateur de programme de développement : filière santé, filière rurale, filière technique'. |
| 22/02/1995 |
Arrêté du 30 janvier 1995 publié au Journal Officiel du 22 février 1995 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Diplôme de spécialisation en appui au développement : filière santé, filière rurale, filière technique'. Observations : Homologation à compter de septembre 1989 |
| 22/02/2004 |
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2005. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
20-07-2022
| Date de décision | 18-07-2025 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 5 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 18-07-2030 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 18-07-2034 |
| Promotions (année d'obtention) pouvant bénéficier du niveau de qualification octroyé |
2023 2021 2022 2024 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 1 | 100 | 67 | 74 |
| 2021 | 34 | 2 | 100 | 56 | 71 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP36705 | Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :